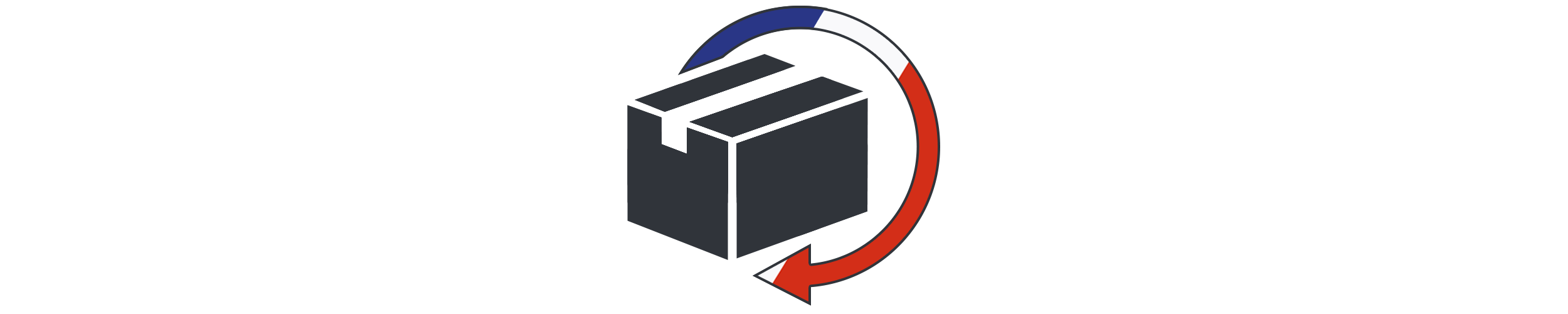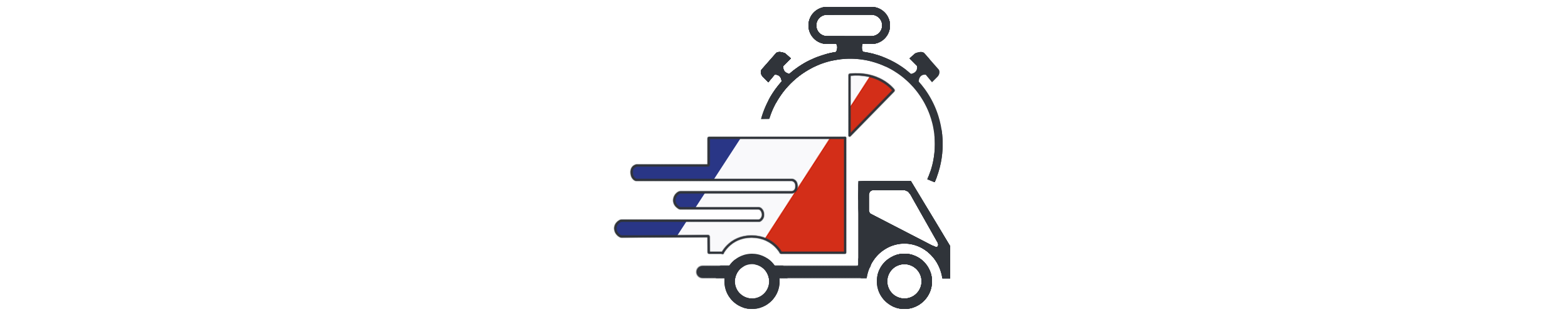Le terme féminisme couvre un large éventail de politiques centrées sur la recherche de relations plus équitables entre les sexes ; c’est le cas du féminisme en Afrique. Cependant, le débat reste très contesté et difficile à définir. C’est pourtant un enjeu majeur du continent africain pour faire évoluer les mentalités et la défense des droits de femmes.
L’histoire du féminisme africain
Le féminisme africain a pris son essor au début du XXe siècle avec des femmes comme Adelaide Casely-Hayford, une militante sierra-léonaise des droits féminins. Elle était appelée féministe victorienne africaine et a largement contribué aux objectifs panafricains et féministes. Charlotte Maxeke a fondé en 1918 la Ligue des femmes bantoues en Afrique du Sud et Huda Sharaawi a créé en 1923 l’Union féministe égyptienne.
Le féminisme d’Afrique en tant que mouvement est également issu des luttes de libération. En particulier celles menées en Algérie, au Mozambique, en Guinée, en Angola et au Kenya. Les femmes se sont battues aux côtés de leurs homologues masculins pour l’autonomie de l’État et les droits des femmes.
Les icônes féministes africaines de cette période sont des femmes comme la rebelle Mau-Mau, Wambui Otieno, les combattantes pour la liberté Lilian Ngoyi, Albertina Sisulu, Margaret Ekpo et Funmilayo Anikulapo-Kuti. Pour ne citer que celles-là… Le féminisme africain moderne s’est consolidé au cours de la décennie historique des Nations unies pour les femmes de 1975 à 1985, ce qui a permis au militantisme féministe et aux bourses d’études de se répandre largement sur le continent et dans la diaspora.
Depuis lors, le mouvement féministe africain s’est développé dans les domaines de la politique, de la législation, de l’enseignement et de la culture. Il est lié à l’activisme de base, à l’activisme intellectuel, aux questions de fond telles que la réduction de la pauvreté et la prévention de la violence.
Ainsi qu’au mode de vie, à la culture populaire, aux médias, à l’art et à la culture. Aujourd’hui, des universitaires, des militants, des artistes et des hommes politiques féministes africains sont à l’avant-garde pour changer les situations qui affectent négativement les femmes.
Ils se servent de l’utilisation de l’activisme, des connaissances et de la créativité pour leur lutte. Les exemples sont légion : Leymah Gbowee, Joyce Banda, Chimamanda Ngozi Adichie, l’Institut africain pour l’égalité entre les sexes, etc…
La redéfinition du féminisme
Les femmes africaines ont consacré beaucoup d’efforts à la redéfinition du féminisme. La pléthore de publications produites sous la vaste rubrique des études sur le genre et les femmes en témoigne. Elles ont été réalisées dans des contextes africains depuis les années 1980. Les penseurs féministes ont beaucoup fait pour fouiller l’histoire des mouvements féminins dans les sociétés africaines.
Certains allaient même jusqu’à affirmer que le féminisme occidental a tiré une grande partie de son inspiration de l’Afrique. Depuis les années 1970, les études anthropologiques occidentales sur les femmes africaines ont souvent été appropriées.
Les divisions de genre des sociétés occidentales patriarcales ne sont ni universelles ni immuables. Elles sont culturellement et socialement construites et donc changeantes.
Comment le féminisme a transformé la société africaine ?
Le premier défi du
féminisme en Afrique est l’appropriation du concept de genre. Après plus de deux décennies, le genre est devenu le langage des Nations unies et des pouvoirs. Au risque de perdre son caractère subversif. C’est un concept conçu pour déconstruire et remettre en question
l’oppression des femmes. Cependant, il est devenu une source de rupture de l’identification en réduisant les
femmes au silence.
La plupart des gouvernements africains ont institutionnalisé des politiques de genre, qui ont été largement utilisées pour reconstruire et réinventer le patriarcat. Il a donc été crucial de récupérer le concept du genre et de garder un œil critique sur ses politiques et son développement. Le second défi a été de poursuivre et d’approfondir la lutte contre les élites conservatrices.
En effet, ils adoptent, par le biais de la culture (de la tradition ou de la religion), la violation des droits des femmes. Les mutilations génitales, la violence domestique ou les mariages précoces, par exemple. En ce qui concerne la culture, il a été souligné que le travail avec la culture doive être considéré comme une opportunité. Toutefois, il y a des aspects qui ne peuvent être évités, à savoir les présupposés qui perpétuent et reproduisent l’inégalité.
Il est important de s’opposer à la défense d’une culture qui viole les droits, en particulier les droits humains des femmes. La culture ne peut pas être au-dessus des droits de l’homme. Les pratiques culturelles préjudiciables qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ont commencé à être dénoncées. Il y a des aspects radicaux qui doivent être éliminés.
La culture en opposition aux droits
D’autre part, la culture est souvent une arme utilisée chaque fois que l’on veut opprimer les femmes et leur refuser des droits. Cette tension constante entre la culture et les droits humains des femmes finit par s’imposer dans la lutte politique. Le troisième défi a concerné la dépolitisation de certaines organisations de femmes en réponse à de fortes mesures répressives contre la société civile.
En effet, dans certains pays, réalisant le potentiel de dissension, les gouvernements cherchent à infiltrer les organisations. Cela afin de les contrôler et de les orienter vers des programmes de soutien. Le quatrième défi a consisté à encourager davantage de féministes à participer à la sphère politique, à s’engager dans le processus de revendication politique et de lutte partisane.
En effet, les féministes, en particulier les jeunes femmes, montrent un manque de motivation et de désir pour le domaine politique, soit parce que les parties prenantes et les partis politiques n’ont pas de propositions attrayantes, soit par peur, soit parce qu’elles vivent un féminisme limité au domaine des droits humains des femmes. L’implication des femmes dans la vie politique est très importante pour influencer les politiques.
Ainsi que pour plaider pour la parité dans les décisions, la lutte pour les quotas dans les parlements et les partenariats à mettre en place pour les programmes politiques. Tout n’est pas encore fait et ses différents obstacles ne sont pas encore tous définitivement surmontés. Mais ce sont quelques luttes autour desquelles le féminisme africain s’acharne.